Dans son livre « Le nouvel âge des femmes au travail », la sociologue Nathalie Lapeyre nous entraîne dans l’un des plus grands bastions masculins d’Europe, l’avionneur Airbus. La directrice adjointe du réseau international et pluridisciplinaire de recherche Mage (Marché du travail et genre) y a enquêté pendant cinq ans, au moment même où l’entreprise déployait sa politique d’égalité avec l’objectif d’atteindre un taux de 20% de femmes cadres d’ici 2020. La chercheuse s’est particulièrement intéressée à la manière dont les jeunes générations de femmes ingénieures, cadres et manageuses, réagissent aux dispositifs d’égalité professionnelle et aux situations de discrimination dont elles font les frais. Interview.
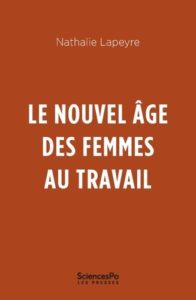 En arrivant chez Airbus, les nouvelles recrues considèrent les inégalités professionnelles comme un « non-problème ». Elles vont même jusqu’à se montrer virulentes face à la politique d’égalité interne de Airbus. Comment expliquez-vous leur réaction ?
En arrivant chez Airbus, les nouvelles recrues considèrent les inégalités professionnelles comme un « non-problème ». Elles vont même jusqu’à se montrer virulentes face à la politique d’égalité interne de Airbus. Comment expliquez-vous leur réaction ?
Le mythe de « l’égalité déjà là » est tenace chez les jeunes générations, femmes et hommes confondus. Il est entretenu par le système scolaire et universitaire qui se veut égalitaire et méritocratique. Il repose aussi sur une méconnaissance des mécanismes inégalitaires. A tel point que les jeunes recrues femmes trouvent incroyable et insupportable qu’on leur parle de discrimination positive. Or toutes les études sociologiques prouvent que les femmes font l’objet d’une sur-sélection à l’embauche par rapport aux hommes, dans un secteur où elles sont minoritaires. En fait, la conscientisation des inégalités débute en général après 35 ans, après les premières maternités, au moment où la carrière des femmes ralentit ou s’arrête.
Votre étude pointe du doigt l’importance pour les femmes d’avoir des « roles models » féminins en interne, mais pas n’importe lesquelles…
Toutes celles qui sortent d’une norme sont systématiquement critiquées, voire rejetées. Par exemple, telle femme dirigeante qui ne prend pas assez soin de son apparence, n’a pas de mari ou pas d’enfant (sous-entendu à cause de son travail, alors que c’est un choix de vie). Ou telle autre, mère de famille, charismatique, connue pour son style de management directif et autoritaire, mais avec une manière de se vêtir jugée un peu trop sexy.
Ces jugements se basent sur des stéréotypes très normatifs de ce que doit être la féminité chez les femmes cadres et dirigeantes.
Mais alors à quoi doit ressembler la dirigeante modèle chez Airbus ?
Elle doit correspondre à un modèle de féminité plutôt occidentale, blanche et bourgeoise. C’est une femme avec de l’autorité mais pas trop, féminine mais pas trop, plutôt « ordinaire » mais pas trop, en couple hétérosexuel, avec enfants, et qui ne soit pas dans l’inversion du genre.
Mais j’ai aussi remarqué l’émergence d’un nouveau modèle identificatoire, en particulier chez les femmes ingénieures devenues cadres et manageuses dont le conjoint a un statut social inférieur ou un salaire moindre. Cette configuration amène les couples à un partage des tâches plus paritaire et même à une implication plus importante des hommes dans le soin aux enfants et l’entretien domestique.
Vous vous êtes aussi intéressée aux effets de l’empowerment, à travers une formation interne destinée à de jeunes femmes cadres à haut potentiel. Quelles conclusions en avez-vous retirées ?
Cette formation a non seulement permis aux participantes de découvrir clairement les objectifs d’égalité de la direction d’Airbus et la réalité de la ségrégation sexuée dans leur milieu professionnel, mais elle a surtout provoqué ce que j’appelle un empowerment transformatif.
Elle a déclenché une vraie solidarité collective et informelle, une sororité, entre des femmes qui de fait, travaillent isolées dans les ateliers, les bureaux d’études, sur les différents sites de production d’Airbus. Des relations d’amitié se sont nouées, des rencontres non-programmées ont eu lieu à la cantine ou lors de déplacements professionnels à l’étranger. Elles se sont entraidées, boostant les plus jeunes, partageant leurs interrogations sur les stratégies de carrière.
Vous relevez le fait que les femmes ont recours à de multiples ruses dont l’humour et les stéréotypes féminins les plus éculés, pour supporter au quotidien des situations d’inégalités. Est-ce vraiment une stratégie payante ?
Il est vrai qu’elles manient beaucoup l’humour et l’ironie. Cela leur permet de mettre à distance certaines crispations internes. L’une d’elle a eu cette formule très drôle : « Si on arrive à monter, on va nous dire que c’est parce que l’on est des femmes quotas. En même temps, avant les femmes qui montaient, on disait : avec qui t’as couché ? Donc, bon, finalement, ce n’est pas plus mal ! »
Jouer avec les clichés est aussi une ruse fréquemment utilisée pour contrer la rétention d’information, demander des explications plus précises. Par exemple, en endossant le rôle de celle qui n’a pas bien compris, de celle qui pose des questions innocentes, en « faisant la blonde ». Ou alors en jouant l’infériorité et la fausse modestie, en valorisant les hommes et leurs capacités… Et ça marche !
Ne perpétuent-elles pas ainsi les stéréotypes qui eux-mêmes sont à l’origine des inégalités professionnelles ?
Bien entendu, il ne faut pas trop user des stéréotypes de genre surtout ceux qui sont péjoratifs sinon on les entérine. Ces femmes les utilisent plutôt pour les transcender, pour contourner le système et passer les obstacles de carrière auxquels elles sont confrontées.
Au final, vous êtes assez critique sur la réussite de la politique d’égalité professionnelle de Airbus. Que préconisez-vous de plus ?
Mettre en place une politique d’égalité c’est très bien, mais on peut s’interroger sur le volontarisme politique de l’entreprise. Quand entendra-t-on un jour un dirigeant d’Airbus, ou de toute autre grande entreprise, réclamer 40% de femmes dans le comité exécutif (à ce jour il y en a 2 sur 12), qui est le vrai organe du pouvoir, de manière similaire à la loi qui impose 40% de représentants du même sexe au sein des Conseils d’Administration ? Ou encore la parité au sein des catégories des cadres supérieurs ?
Airbus a depuis votre enquête lancé un réseau interne dédié au développement des femmes mais mixte. Est-ce une bonne chose selon vous ?
Les hommes qui bénéficient déjà de nombreux privilèges vont donc avoir accès à davantage d’informations et de formations, alors que les femmes en ont déjà si peu… On ne peut symétriser les expériences sociales des hommes et des femmes, où que ce soit, et notamment dans la sphère du travail. C’est comme lorsqu’on compare les violences faites aux femmes et celles faites aux hommes. Les premières sont un véritable phénomène social, cible prioritaire des politiques publiques, les deuxièmes existent mais c’est un phénomène très minoritaire.
Bien entendu, pour mettre en œuvre une politique d’égalité, les femmes doivent pouvoir s’appuyer sur les hommes. Mais ils doivent être des alliés capables de réfléchir avec elles, de faire équipe avec elles. Reste à les trouver…
Le nouvel âge des femmes Nathalie Lapeyre, Les Presses de Sciences Po, 2019



