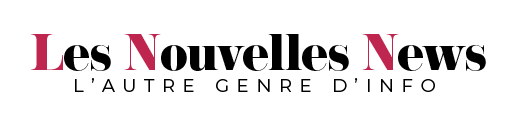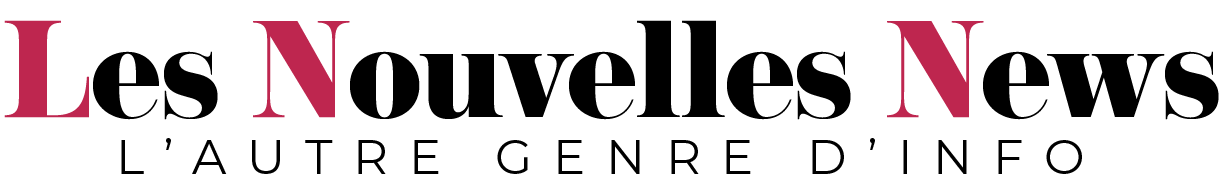À travers vingt-deux portraits de Marseillaises, la journaliste Margaux Mazellier retrace cinquante ans de luttes féministes dans “la ville la plus rebelle de France“. Un matrimoine vivant émerge alors. Rencontre.
LNN : Que signifie « être puissante » ?
Margaux Mazellier – Selon moi, la puissance est collective, joyeuse et empreinte d’un mélange de colère et de douceur lié à cette dimension collective. On entend souvent parler de “puissance“ dans des discours ultra stéréotypés et virilistes. Ce n’est pas ainsi que je l’entends. La puissance, c’est aussi la capacité à aider d’autres personnes à s’émanciper. La série de portraits qui compose le livre met en lumière des personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont réussi à s’émanciper. Mais elles ne se sont pas arrêtées là. Elles ont ensuite été capables de créer des espaces où elles ont pu transmettre cette puissance à d’autres.
LNN : Qu’est-ce qui vous a mis sur la piste de ces histoires, ici à Marseille ?
MM – Je vis à Marseille depuis plusieurs années et cela m’a donné envie de documenter la société et le monde depuis cet endroit. Cette ville souffre d’un tel mépris et est souvent considérée comme la mauvaise élève de la France… Et, pour l’Histoire des luttes féministes, c’est la même chose. Ces récits sont trop souvent racontés d’un point de vue parisiano-centré. Avec Marseille trop puissante, j’ai voulu décaler le regard et raconter les spécificités de la ville.
LNN : De portraits en portraits, vous retracez cinquante ans de féminisme. Quel rapport entretiennent les différentes générations entre elles ?
MM – Aujourd’hui, il y a un grand désir de savoir. Au fil de l’enquête, j’ai pu noter de nombreux points communs entre les militantes des années 70 et celles d’aujourd’hui. Autrefois, il y avait peut-être d’autres mots et d’autres relais théoriques mais la lutte, elle, reste la même. Je pense notamment à la pratique des collages. Dans les années 90, les Ladies Pirates renommaient les rues de Marseille « Clara Zetkin, Rosa Luxembourg et Marie Curie ». Patricia Guillaume, une ancienne membre, se souvient d’une époque où « tout était possible ! ». Aujourd’hui, plusieurs collectifs intègrent le collage à leurs méthodes de lutte, notamment Afrofem, fondé par Lily Lison qui témoigne dans le livre. Cette transmission est importante. Et, malheureusement, elle ne se fait pas toujours dans la sphère familiale. Le premier portrait du livre est celui d’une grand-mère et de sa petite-fille, Julia et Camille. Quand je les ai rencontrées, c’était la première fois qu’elles parlaient ensemble de leur avortement respectif. Julia a utilisé une très belle formule pour parler de ce continuum de la lutte : « Ma génération a ouvert beaucoup de portes. On s’est libérées de tant de choses… C’est un peu comme si on avait ouvert la voie pour que ma petite-fille et les femmes de sa génération puissent en ouvrir beaucoup d’autres ».
LNN : « Je n’ai pas grand chose à raconter… ». C’est ainsi qu’une grande partie des interviewées vous ont répondu. Comment l’interprétez-vous ?
MM – Ce sentiment d’illégitimité raconte bien la manière que les femmes et les minorités de genre ont de ne pas accorder de crédit à leur vécu. Au cours de l’enquête, je tisse des liens entre les trajectoires militantes, personnelles et professionnelles afin de montrer que l’intime est éminemment politique. Quand l’une d’elles – Ursula Blandin, 82 ans – me dit qu’elle n’a rien d’intéressant à me raconter alors même qu’elle a subi des avortements difficiles, parce que c’était encore illégal, et qu’elle s’est battue avec le MLAC de son quartier, c’est profondément politique ! Son combat a fait évoluer les droits et les conditions de vie des Marseillaises. Et, au sentiment d’illégitimité, s’ajoute l’enjeu de prendre la parole là où personne ne l’a fait. Je pense à Heidi. Cette jeune femme trans, racisée et malentendante n’a pas tout de suite accepté de témoigner. Elle a passé sa vie à n’avoir aucun modèle de référence et, pour cette raison, elle a finalement décidé de participer. C’est très courageux de ne pas se sentir légitime et de le faire quand même.
LNN : Dans le livre, vous expliquez avoir procédé par chaîne humaine. Pourquoi avoir privilégié ce mode d’enquête ?
MM – Je voulais que le livre soit une archive vivante et intime de l’Histoire des femmes et des luttes féministes à Marseille. À partir de trajectoires individualisées, j’ai pu retracer ce fil rouge. Fonctionner par chaîne humaine, c’est-à-dire de connaissances en connaissances, a permis de tisser un lien entre les générations et de mettre en évidence un continuum au sein de la lutte. Ainsi, la première femme que j’ai rencontrée, Julia Morandy, âgée de 93 ans, connait, d’une façon ou d’une autre, les dernières, Sihem et Hanen, 16 ans, alors même qu’elles viennent de milieux très différents. Le second intérêt de cette méthode est de rendre compte de l’aspect informel des milieux militants, féministes et associatifs à Marseille. Il y a quelque chose de l’ordre du bouche à oreille. Ces combats sont peu archivés ou commencent tout juste à l’être, alors que c’est une véritable nécessité. Des collectifs, tels que Mémoire des sexualités, Genres de lutte ou encore les Archives du féminisme mènent un travail admirable sur ces questions. Mais, archiver, ça sous-entend des moyens, des personnes formées et du temps, ce que les collectifs n’ont pas toujours.
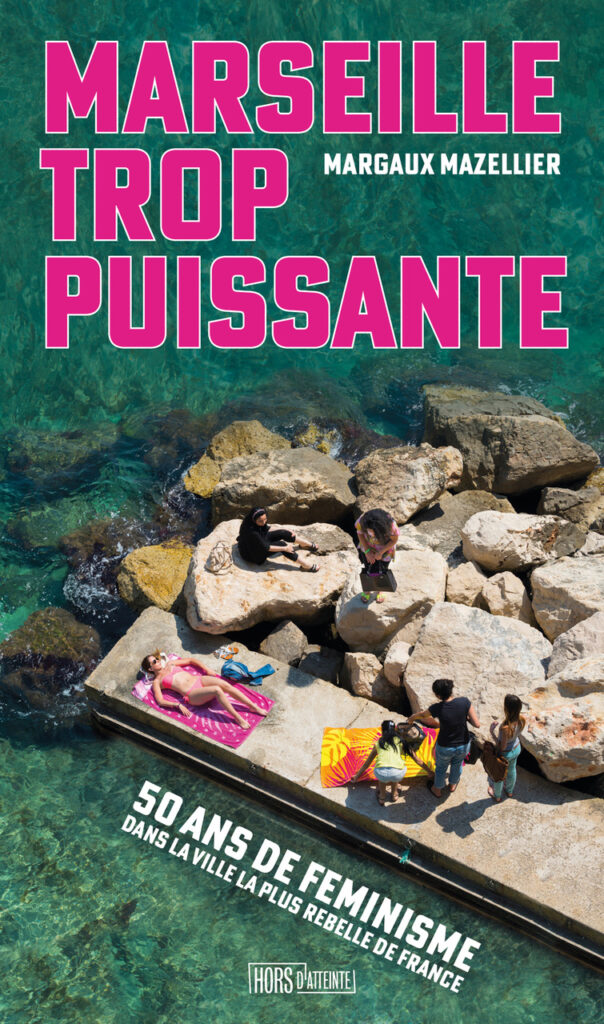
LNN : Vous écrivez que Marseille n’est pas facile à vivre pour les femmes et les minorités de genre. Pourquoi ?
MM – Marseille a été abandonnée par les pouvoirs publics pendant des années. Résultat : pleins de choses n’ont pas été faites. Par exemple, énormément de villes ont un centre LGBTQIA+. À Marseille, cela fait tout juste un an qu’un établissement a été ouvert. Avoir un centre, identifié dans l’espace public, où les questions de sexualité et d’identité de genre sont abordées sans tabou, c’est extrêmement précieux. Progressivement, les choses avancent. Il y a des projets pour que les rues portent des noms de femmes ou que les espaces sportifs soient davantage adaptés aux différent.e.s usager.e.s. Mais tout cela ne peut pas être mené uniquement par des collectifs et des élans individuels. Les pouvoirs publics doivent se saisir de ces questions !
LNN : À quoi ressemble une ville féministe ?
MM – Marseille n’est pas encore une ville féministe. En revanche, elle est rebelle. C’est une ville qui a été opprimée et sa puissance est née de cette histoire sociale, économique et migratoire. Il y a une nouvelle génération de féministes qui prônent un dialogue entre les luttes. Une ville féministe c’est donc ça : un espace dans lequel toutes les personnes discriminées, encore plus celles qui en subissent plusieurs, s’entraident, se transmettent de la puissance et où nos corps de femmes et de minorité de genre sont libres.
Marseille trop puissante de Margaux Mazellier, éd Hors d’atteinte. 304 pages, 17€.
À lire aussi dans Les Nouvelles News :
“Paris féminin” : l’espace public sans femmes
Mère Lachaise : à la découverte du matrimoine funéraire